C’est autour d’un verre dans le bar Le Narcisse que nous avons eu la chance d’écouter Pablo Labèque nous raconter son parcours et sa passion pour son métier. Ses influences, ses méthodes, découvrez de quel bois sont fait les designers et comment ils pensent tous les jours ce que nous aimons regarder.
Bonjour Pablo, tu es designer depuis combien de temps, peux-tu nous dire comment tu es arrivé jusqu’ici ?
Pablo Labèque : J’ai fait mes études à LISAA Nantes, j’ai fini en 2015. Mon parcours est un peu compliqué, à l’école j’étais vraiment un cancre. Après le baccalauréat, j’ai saturé et j’ai décidé d’arrêter mes études. J’ai bossé dans le bâtiment pendant 4 ans. À côté de cela, comme je suis aussi musicien, j’ai commencé à faire des affiches et flyers pour les concerts de mes groupes et ceux des potes.
C’est comme ça que j’ai commencé à apprendre un peu le graphisme, en autodidacte. Puis ça s’est confirmé lorsque je suis parti à Londres avec mon groupe de musique. Londres est une ville très portée sur le graphisme et c’est là-bas que pour la première fois, je me suis rendu compte que j’avais quelque chose à faire dans ce domaine.
Après cette période, je suis revenu en France avec le projet de reprendre mes études. J’avais décroché deux entretiens, un à LISAA Nantes et l’autre à Lyon. L’entretien pour l’école de Nantes était prévu quelque temps avant celui de Lyon. Quand je suis arrivé à Nantes, j’ai eu un vrai coup de cœur pour la ville, si bien que dans la journée, j’ai annulé l’entretient à Lyon pour m’obliger à me donner à fond à celui de Nantes !
Du coup, j’ai été pris et c’est le seul moment dans toute ma scolarité où je me suis senti à ma place. Ensuite, j’ai fait une licence pro à Rennes en conception graphique. J’ai eu mon diplôme avec mention très bien, et le lendemain de mon examen, un mec m’appelle en me demandant si je bossais en freelance. Je me suis donc installé à mon compte pour lui au départ. Petit à petit, d’autres clients sont arrivés et aujourd’hui ça se passe encore comme ça. Je me suis d’abord mis en freelance par défaut, mais j’ai vite compris que ça allait être ma meilleure manière de travailler.
Tu aurais envie de travailler en agence dans l’avenir ?
J’ai déjà travaillé en agence, notamment dans une grosse agence de branding à Paris. C’est très dur pour moi mentalement de bosser pour un client si je ne fais pas tout de A à Z. Ce qui me fait chier dans les agences, c’est que tu fais de la création à la chaîne sans te poser de questions et tu vois jamais un truc fini. Dès qu’on a fini ce qu’on nous demande, le travail est transféré à l’exé, c’est assez frustrant. Si je me retrouve dans une agence, il faudrait que je sois prêt à la défendre.
Juste après mes études, je me suis retrouvé dans un collectif à Nantes. Je m’y sentais vraiment bien et tous les matins j’y allais en courant. Même si c’était une petite agence locale, j’étais prêt à me battre pour eux. Si un jour je décide de retourner dans une entreprise il faudrait que je retrouve cet esprit. Et aussi me dispenser du taylorisme qui pour moi n’est pas une solution dans le design graphique.
Y a-t-il un projet en particulier qui a lancé ta carrière, le premier projet dans lequel tu t’es vraiment investi ?
Je suis hyper reconnaissant de mes premiers clients, qui m’ont fait confiance alors que j’étais personne. En général, il n’est pas conseillé de commencer sa carrière en freelance. Du coup, comme je savais que j’empruntais une voie assez déconseillée, je me remettais en question à chaque projet que je commençais. Dès que je faisais un truc, je l’analysais à fond, c’était hyper éprouvant.
Je devais gagner assez d’argent pour payer mon loyer, mais je m’étais fait une promesse : maintenant que j’avais mes diplômes, je ne mettrais plus jamais les pieds sur un chantier. Du coup, j’acceptais tout. Je faisais des identités, de la pub, de l’édition, du motion design, des sites web, de la scénographie, de l’illustration. Tous les projets m’ont aidé à aller de l’avant, avec la remise en question par laquelle ils passaient.
Puis je crois qu’il y a eu une évolution notable début 2017. L’année a commencé par une période un peu à vide où j’ai vraiment angoissé, puis je suis allé en agence à Paris et là j’ai capté que j’étais vraiment fait pour le free.
Mis à part les aspects liés à la méthode de travail, dont je parlais tout à l’heure et qui ne me convenaient pas, l’agence non plus n’avait pas besoin de ce que j’avais à offrir. C’était du temps perdu et de l’énergie gâchée. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait que je développe mon truc, que j’avais une approche différente et qu’il fallait que m’investisse à fond dedans, avec tous les sacrifices et l’insécurité que ça comprenait.
À ce moment, je me suis un peu lassé de l’ambiance élitiste dans le milieu du design en général. Je me suis rapidement dit que c’était la mauvaise voie pour moi, que je puisais trop mon inspiration dans le design et que je devais aller la chercher ailleurs pour que mes travaux ne parlent pas qu’à une élite intellectuelle. Et les projets qu’on m’a demandés à ce moment-là ont été pour moi l’occasion de creuser ce sillon.

Tu penses que les travaux produits par des boîtes de design ne parlent qu’aux gens du milieu ?
Non pas forcément, c’est un problème qu’on retrouve autant chez certains free que dans des agences ou des studios de toutes tailles. Mais quand j’étais étudiant, en particulier quand j’étais à LISAA et que j’ai commencé à découvrir la typographie, il y a eu des moments où je me suis dit que j’avais perdu la connexion avec mes racines, pourquoi j’avais vraiment voulu faire ça au début.
On nous apprend la bonne conduite et on va volontairement s’enfermer dedans. Je me complaisais à faire des trucs vachement intello et cérébraux et au bout d’un moment, je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout moi. Je repensais aux moments où je faisais de la musique. La musique, c’est tout le contraire parce que tu peux parler directement aux émotions. Je pense que maintenant, c’est un fil conducteur dans mon taf : essayer de parler aux émotions aussi directement qu’avec la musique, mais avec le design.
Donc mi-2017 je suis convaincu que je dois persister dans le free, avec le désir de produire des choses qui ne parlent pas qu’aux designers. Et là, gros coup de chance, c’est à ce moment que j’ai été contacté par l’association Aides. C’est la plus vieille et plus importante organisation à but non-lucratif qui se bat contre le Sida, puisqu’elle a été créée en 1984 par le compagnon de Michel Foucault.
Ce client-là est très précieux à mes yeux parce qu’ils sollicitent chez moi tout cet aspect émotionnel. Jamais avec eux je ne vais avoir recours à des subterfuges, à des feintes graphiques qui ne parleront qu’aux graphistes. J’ai parfois l’opportunité de faire des créations typographiques, des illustrations ou des gros projets d’édition, mais en restant toujours fun et tout public.
Au final ce sont mes meilleurs tafs, car ils touchent autant les designers que les non-initiés. Une autre raison pour laquelle ils plaisent c’est que je m’amuse énormément en les faisant. Je crois qu’en tant que free, on doit vraiment se marrer à faire notre taf. S’il n’y a pas de fun, il n’y a pas d’engagement.
C’est au même moment que j’ai fait la pochette pour Lizard State. c’est une pochette de vinyle qui se transforme en affiche. Quand la pochette est fermée, tu vois qu’une partie et puis tu peux la déplier et tu la vois en entier. Depuis ce projet on m’a beaucoup contacté comme si j’étais le « spécialiste des pochettes d’album », ce qui est cool, car ça me permet de faire le lien entre la musique et le design.
Tu travailles sur pleins de sujets différents, et aussi pas mal sur la sexualité. Est ce que c’est un sujet qui te touche particulièrement ?
Oui et non, tous mes potes me disent que mon job a l’air cool, car à chaque projet, ils ont l’impression que j’ai un métier différent. Surtout avec les pochettes d’albums, c’est très particulier parce que souvent, les clients n’ont pas d’idée, c’est un brief du style : « on a un carré blanc, remplis-le avec quelque chose ». Donc au début c’est très excitant, tu te dis « cool, j’ai le droit de faire ce que je veux ! ». Puis au bout de trois semaines t’as toujours rien fait et ça devient « merde, j’ai le droit de faire ce que je veux… ».
Du coup tu t’inventes des prétextes pour pondre un concept qui te parle. C’est souvent pour moi l’occasion d’injecter des réflexions philosophiques dans la créa, comme pour Lizard State par exemple et toute cette réflexion autour du cerveau reptilien. Je bosse en ce moment sur la pochette d’un groupe de reggae, et pour eux j’ai aussi induit dans le design des questionnements philosophiques, mais cette fois sur l’opposition entre la violence et la parole.
Être designer implique une certaine humilité. Si l’artiste investit sa créativité pour mettre en avant sa propre personnalité, son identité et son histoire, un designer ne va pas exploiter sa créativité pour se mettre en valeur lui, mais pour mettre en valeur les autres. Je pense que cette capacité vient de mes origines landaises. Les Landais de Gascogne, autrefois, c’étaient des mousquetaires : ils mettaient leur vie au service du roi. J’aime bien cette idée, je me mets au service des autres par la créativité.
Alors bien sûr, on me dit souvent que j’ai des facilités dans toutes ces campagnes de communication pour des causes sociales. Je crois qu’au-delà de ça, il y a quelque chose à dire. Qu’on n’apprend pas assez dans les écoles d’art : le design, le graphisme, ça ne sert pas qu’à faire vendre. Le design a une fonction sociale. Avec le graphisme, on a la capacité de rassembler les êtres humains. C’est pour moi beaucoup plus important que le profit ou la vente.
Quelles sont tes principales sources d’inspiration ?
Honnêtement, je ne m’identifie pas trop à ce qui se fait aujourd’hui dans le design. Si je suis devenu designer c’est parce que j’étais surtout le gars qu’on appelle quand on veut une réponse à un problème esthétique. Pablo, fais-moi un dessin sur la couverture de mon cahier de textes, Pablo, joue-nous un morceau de musique, etc. Je crois qu’on doit se poser des questions de designer uniquement pendant l’exécution. Pendant la création, on doit se poser les questions de tout le monde.
Et puis les designers sont trop souvent mus par des tendances ou des gimmicks. Je ne suis vraiment pas le genre de designer qui va aller sur Pinterest pour trouver des influences et des raccourcis vers mon idée. Mon processus est long et méticuleux. En particulier pour les projets d’auteur. Il n’est pas rare que je réfléchisse pendant un an sur un projet avant de le sortir. Mes Leporellos par exemple, ça fait très longtemps que j’y pense. On ne produit pas de travail durable quand on bosse dans l’urgence.
Pour moi, tout démarre avec un papier et un crayon. Ça, c’est un truc qu’on nous apprend pendant nos études, mais que plus personne ne fait après. Personnellement, j’ai découvert l’ordinateur assez tard. Quand j’étais petit, avec mes parents et ma sœur on vivait sans électricité dans une maison en bois au milieu de la forêt avec un groupe électrogène qu’on n’allumait que le soir.
J’ai vraiment eu la nécessité de trouver des moyens de m’occuper sans tout ça, en dessinant, en jouant de la musique, en lisant… Et aujourd’hui dans mon travail, l’ordinateur ne constitue qu’une phase finale. Donc pendant la démarche créative, je travaille avec mon cœur et les clients le voient.
Y’a qu’une seule personne qui m’influence, c’est Hergé. Je pense tout le temps à lui quand je travaille, j’ai grandi avec lui. Que je sois en train de faire de une illustration, de la typographie ou la mise en page d’un bouquin… Y’aura toujours quelque chose qui me fera penser à son univers. On connaît surtout son travail de BD, qui est massif, mais il a aussi produit des choses intéressantes en publicité, affiches, et j’ai toujours été très sensible à la place de la typographie dans Tintin.
Ce qui m’inspire c’est ça, c’est ce qui procure des émotions : Hergé, l’enfance, la musique, la poésie des choses simples… Et puis des gens qui sont plutôt entre art et design, comme Sagmeister, Joseph Beuys, Bruno Munari… La pub je m’en bats un peu les couilles en fait. Je me sens plutôt investi d’une mission vis-à-vis de la culture.

Tu touches à beaucoup d’aspects différents du design, y en a-t-il un dans lequel tu te retrouves davantage ?
Moi si j’aime faire du design, c’est parce que j’aime dessiner, et depuis tout petit. Par exemple, mon goût pour la typographie vient de deux choses. J’ai grandi au Pays Basque, où il y a une tradition de la typographie et du lettrage. Peut être qu’en les voyant petit, ça m’a prédisposé pour ça. Et deuxièmement mes parents écoutent beaucoup de metal. J’ai grandi en voyant beaucoup de pochettes d’album, je pense notamment à Iron Maiden.
J’ai passé un temps fou à les regarder. Puis j’ai retrouvé il y a pas longtemps un cahier de textes où j’avais écrit tous les devoirs en typographie Iron Maiden. Les profs pensaient que j’étais un cancre parce que je n’écrivais pas comme il fallait. Quand je revois ces trucs, je me dis que j’avais déjà un goût pour le design. Donc oui, je pense que ça part du dessin. Parfois quand j’étais en agence je me suis déjà surpris à me dire « mais attends, au final à quel moment tu dessines ? ». À partir du moment où je ne dessine pas, j’ai l’impression de ne pas faire mon métier.
Ensuite ce qui m’anime, c’est aussi beaucoup le souci de l’objet fini. En particulier lorsque je fais un livre, puisque c’est un peu ma spécialité, et que je dois prendre des décisions sur le choix du papier, des encres, dialoguer avec les imprimeurs, veiller à la qualité des finitions…
C’est très important pour moi que mon travail aboutisse en un objet matériel qu’on peut toucher, sentir etc. Savoir que j’ai une incidence sur la matière et que je ne suis pas qu’un producteur d’images. Genre quand j’étais en agence beaucoup de DA présentaient des portfolios constitués uniquement de mockups. J’ai jamais compris ce délire. Ok le book est clean et hyper vendeur mais au bout d’un moment t’as envie de dire : « ok, mais qu’est-ce que t’as fait en fait ? C’est quoi ton incidence sur la réalité ? »
Quand je commençais en free, je me suis pas mal questionné sur l’appellation la plus appropriée pour mon métier. C’était une grosse prise de tête. À l’époque, je faisais beaucoup de covoiturage. J’étais souvent amené à expliquer mon métier en discutant avec les gens. Je me suis vite rendu compte qu’il y avait une mauvaise compréhension.
Si je disais que j’étais designer les gens s’imaginaient que je faisais des chaises. Si je disais que j’étais graphiste, ils pensaient que je faisais des sites web ou de l’infographie. Tandis que l’appellation de directeur artistique est un gros fourre-tout que les gens utilisent surtout pour se faire mousser.
L’activité de direction artistique c’est une vraie discipline qui existe et qui fait partie de nos métiers. Le métier de directeur artistique, selon la taille de l’agence, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Et puis j’ai trouvé satisfaction le jour où je me suis rendu compte d’un truc tout simple : qu’en fait le mot design est un mot anglais qui mélange deux mots français qui sont très proches, « dessin » et « dessein ». Pour moi c’est effectivement ça le design. C’est donner à un objet industriel (une chaise, une maison, une affiche…) son dessein, par le dessin. Ça, c’est ce que je fais tous les jours.
J’ai entendu dire que tu proposais certains travaux au Lieu Unique, peux-tu nous en parler ?
Bien sûr. Il s’agit de trois Leporellos, qui sont de petits objets d’édition qui se présentent sous la forme d’une grande bande de papier repliée en accordéon. Elle peut être soit feuilletée comme un bouquin, sois dépliée et posée sur un meuble pour être plus utilisé comme un objet de déco. C’est un format que j’aime bien, surtout par rapport au volume.
Pour moi, c’est la vision à l’ancienne de se dire que le graphisme, c’est faire des images. Aujourd’hui tout le monde sait plus ou ou moins qu’avec Photoshop, on peut transformer des images. Leur faire dire ce qu’on veut. Même si à une époque ça marchait, les gens ne sont plus dupes. Ils deviennent plus sensibles à des choses authentiques : la texture d’un papier, l’intensité d’une couleur… J’ai toujours abordé mes productions comme des objets et pas seulement comme des images à plat.
Un dépliant, c’est un objet en trois dimensions, tu peux le lire dans plusieurs sens différents. Tu peux le replier dans un sens qui n’a rien à voir et le foutre dans ta poche parce que ça t’arrange mieux. C’est de l’interactivité tout ça. Et c’est ça que j’aime bien, le côté ludique et inattendu, ce que les gens vont pouvoir faire avec. Ça me permet de me dire que mes productions ont une vraie existence dans la réalité. Que les utilisateurs peuvent se les réapproprier.
Le premier c’est une idée qui m’est venue à force de prendre le bus C2. En comatant par la fenêtre, je me suis rendu compte que sur le trajet, il y avait pleins de coiffeurs avec des noms improbables, des blagues à la con. Comme s’ils s’étaient organisés pour se regrouper au même endroit. Le C2 suit une route presque tout le temps en ligne droite. Tu les vois tous les uns à la suite des autres.
Donc je les ai juste listés, il y a hyper longtemps, et quand j’ai voulu faire ces Leporellos j’ai repris la liste et je suis allé les dessiner. Des idées comme ça, j’en ai pleins en stock, mais je ne les mets jamais dehors directement. J’ai besoin de ce temps-là pour les faire mûrir. D’un côté, je vais aussi volontairement les laisser refroidir. Si elles continuent à me hanter, c’est le signe qu’elles valent vraiment le coup !
La deuxième idée est née à Londres. L’année dernière, je participais au festival de design au V&A (qui est vraiment mon musée préféré). J’allais de Bank jusqu’au V&A en prenant la Circle Line, qui est une ligne de métro qui tourne en rond. Elle possède de petites suspensions pour s’accrocher. Et comme je passais tout mon temps dans cette ligne de métro, je me suis amusé à dessiner la manière dont les gens s’accrochaient à ces suspensions. Alors ça, à l’inverse du premier, ce sont des dessins que j’ai fait sur le moment. Il y a quand même un point commun entre ces deux projets, c’est les listes, poétiques et absurdes. J’aime bien faire des listes.
Le troisième, c’est la skyline de Nantes. C’est le genre de dessin que j’ai beaucoup fait quand je suis arrivé à Nantes. C’est une ville pleine d’icônes : architecturales, historiques, artistiques, graphiques… et les nantais en sont très fiers. Toutes les villes ne peuvent pas se vanter d’être immédiatement identifiables à leur simple silhouette. On parle tout le temps de la skyline de New York, Shanghai, Toronto… Pourquoi jamais Nantes ? C’est pas donné à tout le monde de vivre dans une ville dont les habitants sont aussi fiers. Ils aiment bien avoir chez eux des illustrations qui la représentent. Ça me fait du bien d’être dans une ville comme ça, une ville aussi visuelle.
Ces trois Leporellos sont en vente à la librairie Vent d’ouest au Lieu Unique. Mais aussi à la librairie de la HAB galerie.
As-tu des projets en cours, que tu es en train de finaliser ?

Je bosse sur plusieurs pochettes d’albums, dont une pour un groupe de reggae, dont je parlais tout à l’heure. Ils m’ont demandé de créer un caractère typographique qu’ils pourront réutiliser sur toutes leurs communications. C’est vraiment sympa de bosser là-dessus parce que je fais pleins d’expérimentations à la main avec des craies et des pigments. Les recherches sont parfois plus belles que le résultat final !
Je suis aussi en train de réaliser un livre pour une grosse organisation à but non-lucratif. Elle mène un certain nombre d’actions dans le milieu de la santé. J’ai convoqué encore une fois une réflexion sur la notion de rhizome, à laquelle je vais donner une incarnation graphique. Et sinon je suis en train de préparer un très gros projet sur Nantes. Je bosse dessus depuis trois ans et il commence à toucher à sa fin. Mais c’est encore trop tôt pour en parler, je préfère encore garder le mystère !
Retrouvez les travaux de Pablo directement sur son site internet ou son Instagram !
L’interview de Lucile Jousmet est juste là.
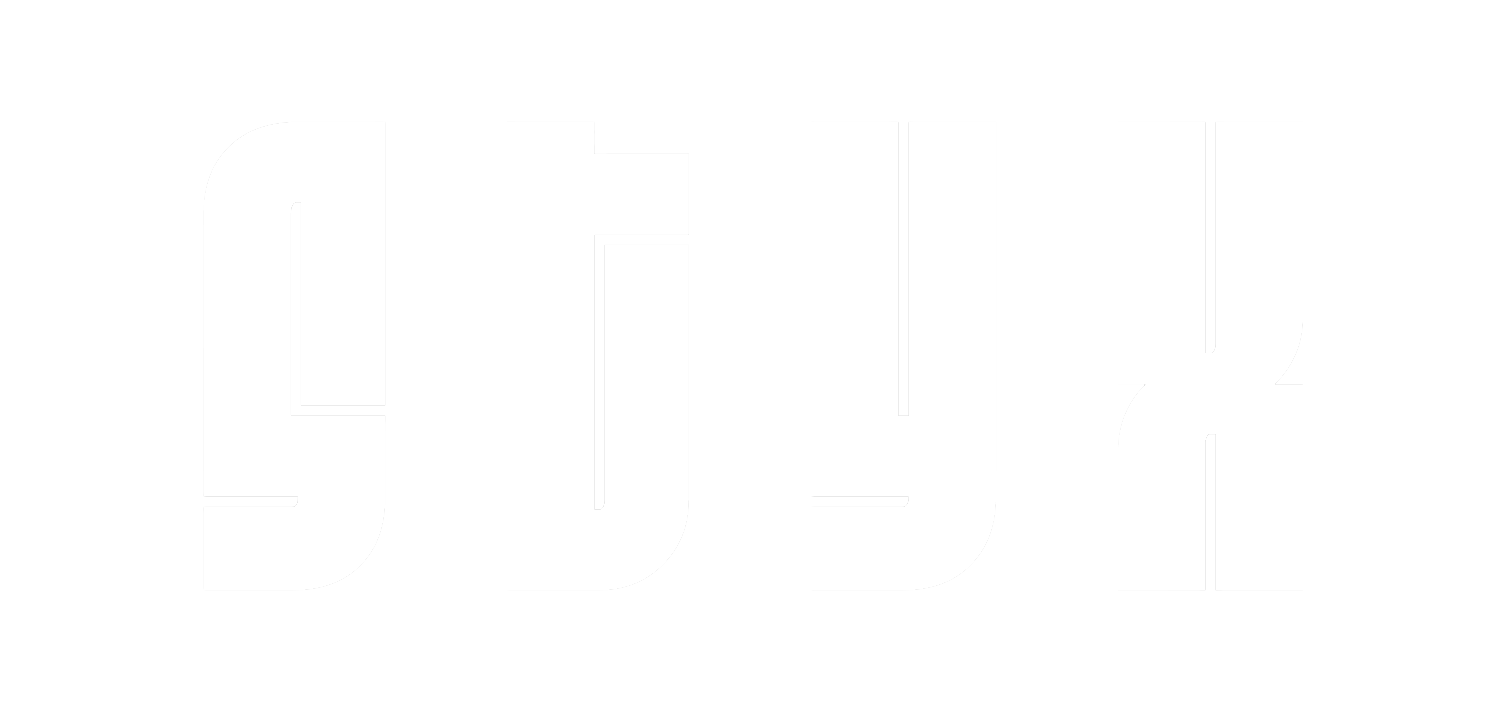
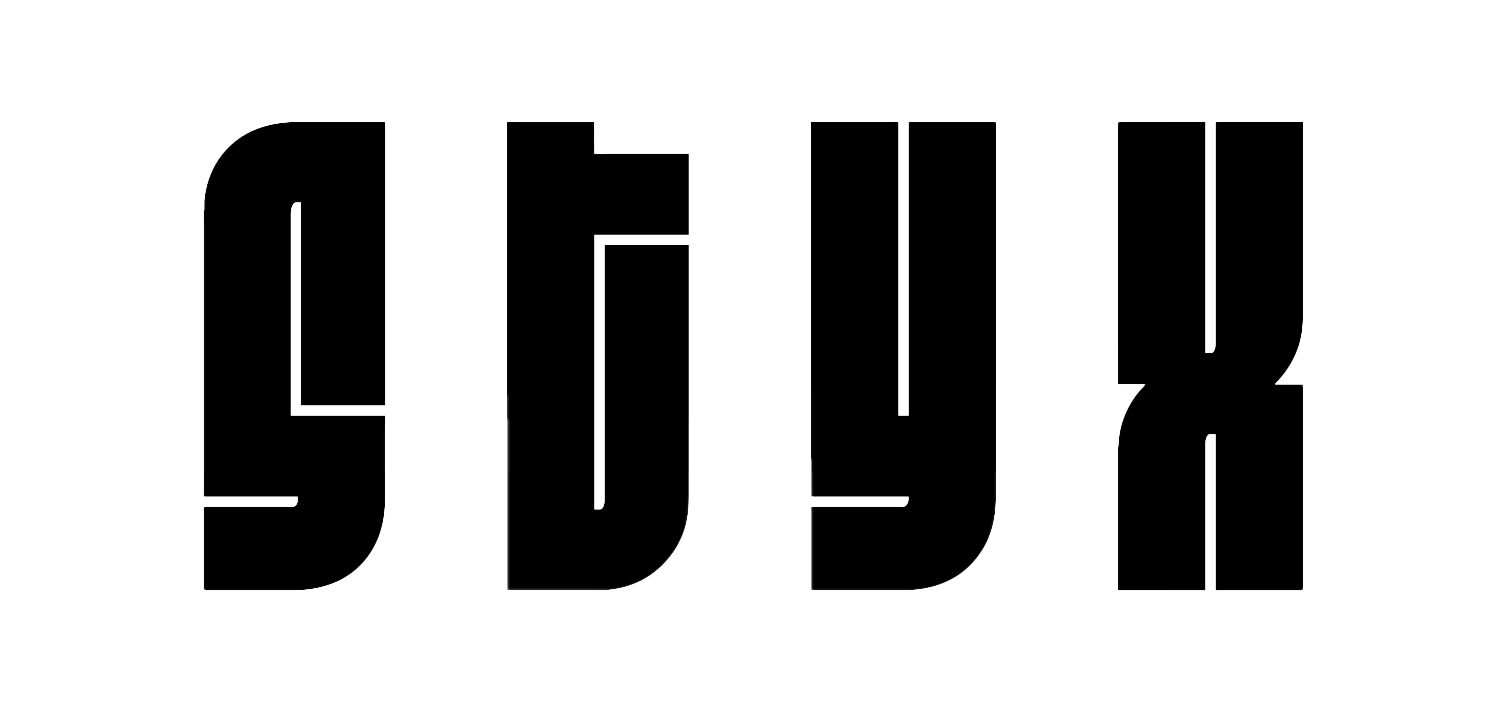







Comments